La force de la LPO réside dans sa couverture territoriale et son maillage de proximité permettant l’implication conviviale et militante de nombreux citoyens dans les activités et les combats menés par l’association en faveur de la biodiversité.
LPO AuRA
100 rue des Fougères
69009 Lyon


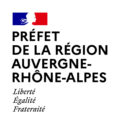
LPO AuRA
100 rue des Fougères
69009 Lyon